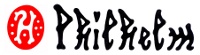- Babylonien
- Minoen
- Étrusque
- Pinacothèque

B143 – SCEAU DE BEL-MUSHALLIM, QUI ENLEVE CE SCEAU, RISQUE DE PERDRE LA PROTECTION DE SHAMASH !
Acrylique sur toile – Châssis cintré – 127 x 85cm.Tout savoir sur cette toile
- 2011
- 155 - Chasse antique achéménide...
- 2010
- 149 - Quand Ninurta chassait Anzu...
- 146 - Liberté, quand les Dieux...
- 143 - Sceau de Bel-Mushallim...
- 110-5 - DIPTYQUE B109 & B110
- 110 - Quand les poissons sortirent de l'eau..
- 2009
- 132 - Combat entre un homme cornu...
- 123 - Ronde légumenomorphe d'Ur...
- 115 - Deux chameaux en lutte...
- 114 - Divorce à la babylonienne...
- 113 - Centaure cornu ailé sassanide
- 112 - Cheval ailé sassanide
- 111 - Quand une balinaise embarque avec Benu...
- 109 - Quand les Dieux étaient des hommes...
- 108 - Tall Munqaba 2
- 107 - Tall Munqaba 1
- 106 - Quand une reine nue sollicite l'intercession...
- 105 - Quand Râ, Horus et Isis étaient ...
- 104 - ADDA le scribe
- 103 - Sceau de Tariba Ishtar
- 2008
- 102 - Quand un roi sumérien rencontre son dieu
- 101 - L'Arbre de Vie dans son jardin babylonien
- 100-5 - B99 & B100 Diptyque babylonien
- 100 - Sceau de Talmi-Teshub roi...
- 099 - Laisse-le, lui qui croit en toi...
Tout savoir sur cette toile
BABYLONIEN / Dans le mythe sumérien du déluge bien avant celui de la Bible, le dieu Shamash apparaît dans une barque et ramène la lumière après l’orage ! Ainsi Shamash est le soleil levant, dont le plafond représente le ciel et qui contient la barque du soleil ! Nous savons grâce à « L’épopée de Gilgamesh » que le batelier de Shamash s’appelle Urshanabi (mi-homme, mi-barque). Le serpent-bateau est un allié contre les épreuves que doit affronter le Dieu pour vaincre les forces opposées à la lumière ! Dans le poème « Une épopée babylonienne », il est dit expressément que nul, en dehors de Shamash, ne saurait franchir la mer ! Sur le pont du bateau, l’anthropomorphe à quatre pattes était initialement un triste vieillard barbu et non une femme. Quand aux nombreux attributs sacrés au-dessus des personnages, leur signification reste mystérieuse, à part le Monogramme de Philhelm ( qui a été rajouté par votre artiste iconoclaste) sous l’inscription cunéiforme , dont la traduction mot à mot est « Sceau de Bel-Mushallim*, qui enlève ce sceau, risque de perdre la protection de Shamash ! »
*« Bel » en akkadien = Maître / Seigneur
SHAMASH : autrement translittéré Šamaš, est le nom akkadien du dieu Soleil et de la Justice dans le panthéon mésopotamien. Les sumériens l’appelaient UTU. Il occupe une petite position secondaire dans la hiérarchie divine par rapport au dieu Lune Sîn. Cette infériorité s'explique très vraisemblablement par la prééminence du calendrier lunaire sur le calendrier solaire. Néanmoins, ces deux divinités astrales furent mises très tôt en relation dans l'architecture. Ainsi le temple de Shamash jouxte fréquemment celui de Sîn dans les ensembles cultuels assyriens, évoquant ainsi les tentatives de mise en correspondance des deux systèmes calendaires. Le plus souvent, on attribuait la justice à Shamash. Tout comme le soleil disperse les ténèbres, Shamash expose en pleine lumière le mal et l'injustice. Hammourabi place son code sous les auspices de Shamash, l'inspirateur des lois, et sur ce même recueil, le roi se fait représenter en adorateur du dieu solaire. Plusieurs siècles avant lui, le roi Ur-Engu de la dynastie d'Ur (vers 2600 ans avant J.-C) disait rendre ses décisions « en accord avec les lois justes d'UTU ». Dans la mentalité mésopotamienne, cette fonction de justice peut être logiquement mise en relation avec celle de guérison. Shamash est en effet celui qui libère les humains de l'emprise des démons. Le dévot malade peut faire appel à Shamash pour le délivrer d'une souffrance qu'il considère comme injuste, comme en témoignent les hymnes au dieu soleil. Shamash a peu à peu éclipsé en les absorbant toutes les autres divinités du soleil. Dans le panthéon systématisé, les autres dieux solaires deviennent les serviteurs, ou des aspects particuliers de la déité principale. Le dieu Soleil Shamash était également capable de tout voir, c’est pourquoi Il fut ainsi associé aux questions de justice et de divination comme UTU son prédécesseur. Ce rôle l'impliquait directement dans les décisions politiques et sociales prises par les rois. Son symbole est un disque orné d'une étoile à quatre branches séparées par des faisceaux de rayons ondulés. Il est caractérisé sur des monuments par des flammes qui s'élèvent au-dessus de ses épaules.
« L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH » : est un récit légendaire de l’ancienne Mésopotamie (Irak moderne). Faisant partie des œuvres littéraires les plus anciennes de l’humanité, la première version complète connue a été rédigée en akkadien dans la Babylonie du XVIIIe siècle av. J.-C. ou XVIIe siècle av. J.-C.; écrite en cunéiforme sur des tablettes d’argile, elle s’inspire de plusieurs récits, en particulier sumériens, composés vers la fin du IIIe millénaire ; elle est à rapprocher d’« Enki et Ninhursag », d’« Enûma Elish » (Lorsqu’en haut…) et du « Atrahasis » (Poème du Supersage). Elle a pour origine des récits mythiques ayant pour personnage principal le roi Gilgamesh, cinquième roi (peut-être légendaire) de la première dynastie d’Uruk (généralement datée de l’époque protodynastique III, vers -2700, -2500), selon la liste royale sumérienne composée pendant la première dynastie d’Isin (-2017, -1794).Selon l’opinion commune des assyriologues, le récit du Déluge, inspiré par l’Épopée babylonienne d’Atrahasis ou « Poème du Supersage », a été ajouté vers -1200, pour former le texte « standard », comprenant onze tablettes, de l’épopée assyro-babylonienne. La douzième tablette, traduction de la seconde moitié du récit sumérien « Gilgamesh, Enkidu et le séjour des morts », a dû être ajoutée vers -700.Ce sont des tablettes d’écriture cunéiforme du VIIIe siècle av. J.-C. trouvées dans les fouilles de la bibliothèque du roi Assurbanipal à Ninive qui l’ont dévoilée au monde dans les années 1870, à partir notamment du passage concernant le Déluge, qui fit sensation à l’époque. Cette épopée avait connu un grand succès dans le Proche-Orient ancien, et des exemplaires ont été retrouvés dans des sites répartis sur un grand espace, en Mésopotamie, Syrie, et en Anatolie ; elle est attestée jusque dans les textes de Qumrân, peu avant l’ère chrétienne. Elle avait été traduite en Hittite et en Hourrite. Les sources sont sumériennes, babyloniennes, assyriennes, hittites et hourrites. Les tablettes seront d’abord traduites par Georges Smith, protégé de Henry Rawlinson.De récents travaux rapprochent l’épopée de Gilgamesh des 12 travaux d’Héraclès (l’homologue grec du héros romain Hercule), la légende babylonienne étant antérieure de près de 1 000 ans aux écrits d’Homère.
« UNE EPOPÉE BABYLONIENNE » ou Enuma Elish : (Lorsque en haut ...) est l'épopée babylonienne de la création du monde. Le texte fut découvert au XIXe siècle sous forme de fragments dans les ruines de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive (proche de l'actuelle Mossoul en Irak).Cette version de l'épopée, qui date probablement du XIIIe siècle av. J.-C., est composée de sept tablettes d'argile couvertes d’écriture cunéiforme. La plus grande partie de la cinquième tablette n'a jamais pu être retrouvée. Mis à part cette lacune, le texte est quasiment complet.L'épopée décrit l'élévation de Mardouk, dieu tutélaire de Babylone, au-dessus des autres divinités mésopotamiennes ainsi que la création du monde et de l'Homme. Il existe diverses versions de Enûma Elish, la plus ancienne datant probablement du IIe millénaire av. J.-C.