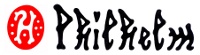- Babylonien
- Minoen
- Étrusque
- Pinacothèque

Tout savoir sur cette toile
- 2014
- 180 - Préliminaires amoureux chez les Mimbres
- 2013
- 175 - Chasse amérindienne ordinaire...
- 174 - Cinq vies des Mimbres de Mogollon
- 169 - L'ORIGINE DU TIGRE SUR TERRE...
- 2012
- 168 - L'ORIGINE DU CHEVAL SUR TERRE...
- 167 - LA LETTRE D’AMOUR YOUKAGUIRE
- 166 - BRACTEATE D’UNE CAVALIERE...
- 164 - Diptyque bracteates des dieux ....
- 163 - Victor Brauner, entends-tu ma musique ?
- 162 - Bractéates de 12 cavaliers en furie...
- 2011
- 161 - Enlévement d'une joyeuse sabine
- 160 - Clin d'oeil philhelmien à Victor Brauner
- 158 - Cheval scythe à l’arrière-train retourné
- 157 - Noyade des envieux par péché d’orgueil
- 154 - Dieu scandinave à cheval et un oiseau...
- 153 - La déesse de l’amour Freyja à cheval
- 152 - Entre la mort d’un fils et le désespoir...
- 2010
- 140 - Déplacement royal d'Hor-Aha...
- 138 - Japonisme d'Aristote...
- 134 - Catdog
- 2009
- 118 - La bête de l'Apocalypse...
- 116 - Entrelacs chien et chienne...
- 2008
- 098 - Rapace avec poisson
- 097 - Le taureau à l'épi...
- 096 - Cheval couché
- 2007
- 133 - Hommage à Victor Brauner
- 084 - Femme aurige celte dans pleine lune
- 2006
- 069 - Lapin syrien
- 068 - Paon syrien XIème
- 067 - Ziz bird ...
- 066 - Antilope fatimide
- 065 - Zébu d'Asie centrale
- 064 - Oiseau Manisès XVIème
- 063 - Fabuleux orchestre anthropomorphe...
- 062 - L'APOCALYPSE
- 2005
- 060 - Fantaisie grotesque animalière
- 059 - Le convoi fantastique 2
- 058 - Le convoi fantastique 1
- 057 - Réinterprétation des images ...
- 056 - Naissance du protestantisme ...
- 050 - L'alphabet de la mort
- 2004
- 049 - Bacchus
- 048 - L'horloge des 12 dieux du vent...
- 2003
- 036 - les douze signes du zodiaque ...
- 035 - Etude couleurs pour LEO...
- 2002
- 034 - Les ménestrels
- 033 - Trois enfants aux oiseaux
- 2001
- 032 - De toutes les choses qu'on peut savoir
- 1999
- 030 - Fille au tambourin
- 029 - Du monogramme de Philhelm...
- 1998
- 028 - Le triomphe d'Anvers
- 027 - Etude pour le triomphe d'Anvers
- 026 - Sept enfants dansent une ronde...
- 025 - Danse 2
- 024 - Danse 1
- 1997
- 023 - Jeune cavalier...
- 021 - Cachette du monogramme de Philhelm
- 1996
- 022 - Glorification de l'abondance
- 019 - Le fils de Hans Leininger avec un chien
- 015 - Ab ovo...
- 013 - Croix humaine sur la flèche ...
- 012 - Apparition d'une créature ailée...
- 010 - Chiens andalous du 16ème
- 009 - Enfants avec une girafe
- 008 - Jeune fille en équilibre sur un crocodile
- 007 - Trois enfants et un félin dans une grotte
- 006 - L'attente du père
- 1995
- 004 - Les trompettes de Jéricho ...
- 1994
- 002 - Argentora
Tout savoir sur cette toile
Ce magnifique animal était un ornement d’harnachement d’un cheval certainement princier, parce que retrouvé dans un grand kourgane de la ville de Sagly-Bajy dans la région de Touva à la frontière de la Mongolie. (Le grand guerrier s’était fait enterrer avec ses armes et peut-être son cheval, sans oublier des récipients ayant contenu de la nourriture.) L’original en bronze est au Musée de l’Ermitage à Saint Petersbourg, il mesure 4,2 x 5cm et date du IV siècle avant J.C. Pour le plaisir de le découvrir à nouveau, le voici présenté à ma manière avec une fleur entre les dents. Il est sculpté en bas-relief en négatif dans une tablette de divers bois de sapins assemblés voilà une cinquantaine d’années, puis à partir de ce moule, j'en ai fait un tirage unique en plâtre armé. Je l'ai rehaussé ensuite pour lui donner plus de volume, et ce, avec des composants de polyesters, puis je l'ai poli, puis le peignis avec des acryliques, pour le terminer par un maillage de petits cercles en superposition avec des peintures interférentes mixées à des iridescentes. Abordons maintenant l'art des steppes ou art scythe, qui est un art essentiellement composé d'objets décoratifs comme de la joaillerie, les décorations des armes et de l'équipement du cavalier, du harnachement des chevaux, produit par les tribus nomades de la steppe pontique qui s'étendait du Kazakhstan moderne à la mer baltique. Ces nomades étaient parmi les plus anciens éleveurs de chevaux du monde ! Les peuples nomades ont représenté de nombreuses scènes de chasse et de combat entre animaux. Le thème du fauve, un félin ou un ours se jetant sur sa proie, est très fréquent. Des scènes quotidiennes d'élevage des chevaux et des moutons sont également représentées. L'art assyrien a apporté le goût du réalisme et du naturalisme à ses peuplades, qui s'est ensuite transmis dans toute l'Eurasie, et notamment les peuples germaniques et asiatiques. La Chine a reçu un important apport de réalisme de l'Art des Steppes au cours de diverses invasions mongoles. Des deltas de la Mer Noire aux plaines de Mongolie s’étend l'immense bande des steppes. Elle traverse tout le continent asiatique. Elle est la route des nomades, qu'il ne faut pas confondre avec la route de la soie, qui reliait entre-elles, plus au sud, les villes des sédentaires. Les nomades ont toujours fasciné les sédentaires. Ils leur ont emprunté des techniques, comme la métallurgie, et avec ces emprunts ils ont développé une culture puissamment originale en leur apportant les échos de mondes inconnus. L'art des steppes garde sa part de mystère. Il est né nulle part. Il a le goût raffiné des gens du voyage qui savent happer le meilleur sur leur passage pour le transformer selon leurs exigences. Rien de commun avec celles des peuples qui ont pignon sur rue, qui bâtissent des palais, des silos, des sanctuaires où ils peuvent accumuler, s'étaler, se perdre en longues diversions. L'art des nomades va droit à l'essentiel, il ne sépare pas l'utile de l'agréable. Il ne tolère pas de poids mort, juste le strict nécessaire, mais imprégné des gestes et des rites quotidiens. « L’art scytho-sibérien des steppes représente incontestablement l'une des communions les plus saisissantes de l'homme avec l'univers » dixit André Malraux. Dans cette immense zone, toutes ces populations, aux cultures différenciées mais qui toutes semblent accorder une importance majeure au rituel chamanique (dans lequel l'animal joue un rôle prépondérant), créent dans un souci d'efficacité magique un monde de créatures étranges, influencé tantôt par la Chine, tantôt par le Proche-Orient. Véritable trait d'union entre l'Extrême-Orient et le monde occidental, elles seront à l'origine du répertoire ornemental des Celtes, des Vikings et de celui des Barbares du haut Moyen Âge. Cette aire immense sépare et relie en même temps celles des grandes civilisations sédentaires de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Inde et de la Chine. Celles-ci ont souvent perçu les nomades comme des primitifs jaloux des richesses des « civilisés » et rôdant comme des loups à leurs frontières. Quand elles ont commencé à se disperser, ces tribus connaissaient déjà la métallurgie du cuivre. Ce n'est que récemment, grâce aux découvertes archéologiques accumulées depuis le XIXe siècle, que l'on s'est avisé que les nomades avaient peut-être développé un autre type de « civilisation » et que leurs échanges culturels avec les sédentaires ne s'étaient pas toujours faits dans le sens que l'on imagine. Nous leur devons par exemple l'art du tapis, des progrès dans les techniques d'équitation et l'armement, certains motifs décoratifs animaliers qui ont influencé jusqu'à l'art roman d'Occident. L'imaginaire des nomades a marqué celui de leurs voisins, en Iran avec le cycle de Roustam « le Sace » et sans doute en Occident avec quelques thèmes des légendes arthuriennes hérités de Sarmates cantonnés par l'armée romaine en Angleterre aux IIe-Ve siècles. Mais à partir des derniers siècles avant J.-C., ces nomades à dominante indo-européenne furent concurrencés en Asie, puis progressivement refoulés ou assimilés, par des peuples à majorité ou forte composante mongoloïde, parlant pour la plupart des langues de la famille altaïque : turques, mongoles ou toungouses. Une caractéristique des sociétés nomades est la liberté, voire le pouvoir, dont y jouissaient les femmes. Chez les Sauromates puis Sarmates des steppes russes, chez certains Saces d'Asie, elles pouvaient porter les armes et combattre comme les hommes et avaient des fonctions religieuses importantes.
Kourgane : Un kourgane est un tumulus, en fait, il s'agit d’un monticule, voire d’une colline artificielle laissé par une population qui vivait au Néolithique entre le V et le III siècle avant J.-C., dont la grandeur est proportionnelle à la qualité du personnage enterré en son sein dans une tombe, souvent gelée dans ces régions de la Sibérie, et ayant ainsi échappé plus de deux mille ans aux pilleurs de tombes.
Steppe pontique : Une vaste steppe du nord de la Mer Noire, elle fait partie d’un plus grand ensemble appelé steppe eurasienne.
Altaï : qui signifie « Les montagnes d’or » est une zone montagneuse comprise entre la Russie, la Chine, la Mongolie, et le Kazakhstan.
Toungouses : Groupe de peuples de Sibérie de la région de Toungousta : les Evenks, Lamoutes, etc. Pour mémoire, deux rappels intéressants : 1° Les Mandchous ont des origines toungouses. 2° Les termes chamanes et chamanisme sont d’origine toungouse.
Addendum : Etonnant, l’influence de l’art des steppes dans l’art assyrien ! Vous n’ignorez pas qu’entre 2008 et 2011 j’ai peint une vingtaine de tableaux babyloniens inspirés de l’art assyrien !
La critique artistique de Jean-Paul Gavard-Perret:
CHEVAL DE TENEBRE ET DE LUMIERE Le cheval est devenu la vie psychique des pulsions. Il est la fable humaine, le galop du monde, le bord des miasmes, quelque part entre solitude et liberté. Contre l'intégrité de l'étendue, le cheval impose soudain une configuration, un agglomérat. C’est l’amorce du seul récit. Celui qui transgresse l’ordre narratif des histoires et des lieux pour projeter en une sorte de limbe.
Restent des disjonctions au sein du corps de cheval : plus on va de haut en bas plus se fragmente et devient abstraction. Nos fantômes ne sont pas loin : restent des éboulis qui renvoient l’espérance habitable. Malgré tout.
La détermination du cheval en double résulte d’un choix bien plus que stylistique : c’est un foyer vital qui refuse toute neutralité au profit d'un engagement intime, essentiel. Surgit l’interaction sans ancrage temporel précis dans les reprises du temps et des archéologies.
Même s’il s’agit d’une scène-type le flottement demeure. Il est contextuel, consubstantiel à la peinture de Philhelm. C’est un récit et un constat où la qualité du noir qui environne les fragments de cheval borde sa présence infiniment lointaine et proche et dont l’impondérable prend des allures de symboles.
Le caractère rituel d’une telle séquence en vis à vis où la symétrie est contredite par les couleurs prend une valeur récursive compte tenu du monde inachevé de l’action de dévoration présentée. Cela ouvre l’œuvre à d’autres catégories discursives.
La diérèse dans son incertitude ne marque en réalité aucune évolution, aucune progression significative. Ce que le peintre montre possède la force qui taraude l’indémêlable sentiment de la solitude et de la présence, avers et revers d’une même médaille.
Le cheval dédoublé offre la révélation de toute sa présence qui emporte in fine sur toute velléité de fermeture. Par la faiblesse des repères temporels l’artiste déloge du registre aussi bien fictionnel que platement autobiographique.
C’est pourquoi sa subjectivité ne peut se regarder comme telle, mais plutôt comme une impression sensible que le spectateur fait sienne sans pour autant que celui-ci soit confronté et risque de tomber dans une peinture de type «moralisatrice ».
Un autre aspect intéressant du paradoxe de cette peinture tient au fait qu’elle n’expose pas celui qui la regarde à une sensation d’anonymat ou à un sentiment global d’abstraction. Il y a là une puissance émotionnelle qui cloue celui qui regarde à la plus forte des interrogations. Celle qui demeure ouverte le diptyque en fait foi - : il n’y a pas de réponse à la fable humaine. Jean-Paul Gavard-Perret